
Dans cette simple citation, c’est toute l’évolution entre le Faust I et le Second Faust qui s’énonce, entre ce premier texte publié en 1808 où tout sombre dans le néant et le second achevé en 1831 où Faust est sauvé.
Dans le Second Faust, Faust, après l’expérience vécue dans la sphère individuelle, se confronte au « grand monde », à l’univers objectif de la société, de la culture et de l’histoire à travers l’expérience de la puissance, de la beauté, et de l’action créatrice.
A la fin de cet itinéraire Faust connaîtra le fruit de ses efforts et sera, à son tour, « sauvé ». Cette figure de Faust consacre ainsi un nouveau rapport du désir (« Aie le désir de désirer ») et de la puissance qui lui fournit une justification pour balayer un ordre des valeurs.
Et c’est pourquoi il est sauvé.
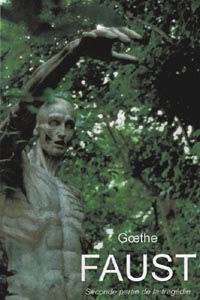
Ne pas le sauver ce serait faire de la figure de Faust un épouvantail qui aurait justement pour mission de faire reculer les audacieux, de maintenir le pouvoir et l’ordre des valeurs établis.
Il s’agira ici de tenter théâtralement d’aller au-delà de l’expression de l’humanisme insignifiant et lénifiant d’aujourd’hui qui sauverait Faust - si ce n’est la morale.
Mais cette tentative de représentation voudra s’interdire l’acte trop positif de destruction, déstructuration des codes où le corps rescapé se dresse comme dernier signe du et pour le vivant.
Ce dépassement alors souhaité pourrait être d’ordre négatif avec l’ordre établi, ni une violence, ni un décalage mais tout simplement, l’essai de remplir des coquilles vides, composées - pour notre regard - par la multiplicité des moyens esthétiques employés dans Le Second Faust : mascarades carnavalesques, féeries, ballets mythologiques, marionnettes de foires, allégories, opéra... en poussant vers le vivant ces formes expirantes. Ces formes en manque de continuité, cette recherche théâtrale voudra aider à en dépasser la simple évidence culturelle - comme l’évidement culturel d’ailleurs - ainsi que d’autres plus contemporaines : l’opérette, le sit-com...
Ainsi la volonté de monter cette oeuvre insolite et drôle d’un style baroque foisonnant nous mènera sans doute à revenir à la tentative peut-être impossible mais encore pensable - toute empreinte de l’héritage médiéval, fondement du Second Faust - de représenter, en une image naïve et reconnue comme telle, un « mystère » ou bien plutôt une étrangeté qui émanerait de la terrible présence humaine.
Pour moi, il s’agira de croire en la possibilité de représenter le monde, de lui faire face sans avoir le courage de le détruire ou tout au moins sans le courage de détruire les codes de représentations de lecture du monde qui mènerait vers une redéfinition du corps de l’acteur et de son espace, mais avec la volonté de l’affronter tout en ayant la peur tenu au ventre, comme un défi lancé à la figure tutélaire de Faust.
L’intention de travail pourra alors d’abord s’énoncer comme suit :
Retenir, contenir le terriblement humain dans le figurable, le faire affleurer et puis le libérer dans / par la langue de Goethe pour pouvoir à chaque fois s’étonner de pouvoir en ressortir vivant.